
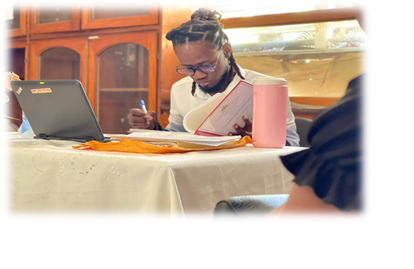
Le mardi 4 février dernier, nous avons défendu notre mémoire de sortie2 à la Faculté des Sciences Humaines de l’Université d’État d’Haiti comme exigence d’obtention d’une licence en sociologie. Si tant est que l’expérience fût passionnante et très instructive, elle reste l’accomplissement de plusieurs années de sacrifices, de douleurs et également de plaisirs et de rires, bref, de tribulations mêlées d’une joie de vivre3. En témoigne la richesse de la discussion réalisée à l’occasion, et surtout la nature de quelques critiques et recommandations éclairantes proposées, nous nous sommes trouvé dans l’obligation de livrer ces quelques lignes. Lesquelles ne prétendent aucunement prendre en compte toutes les spécificités et la profondeur du texte initial, mais de préférence un cadre plutôt synthétique qui rend compte des objectifs globaux du travail. Donc, le but, c'est surtout de dresser le squelette de notre rapport de recherche, ce qui,
nous l’espérons, peut faciliter sa lecture. Aussi, il entend montrer l’exactitude des dispositifs méthodologiques et théoriques qui poursuivent l’ambition de renouveler les grilles de lecture sur la question organisationnelle et du développement, surtout dans un cadre rural. En fin de compte, ce texte nous servira d’introduction à d’autres articles bien plus systématiques que nous aurons à travailler en lien avec notre préoccupation de recherche. Ainsi, nous proposons d’abord de présenter brièvement les éléments qui structurent notre problématique tout en inscrivant la recherche dans son contexte scientifique de production. Ensuite, de mettre en lumière les aspects théoriques et méthodologiques. Et enfin, présenter de manière synthétique quelques résultats obtenus.
L’objectif de départ était de scruter l’état de la littérature disponible sur la paysannerie haïtienne globalement, en particulier sur des organisations paysannes en rapport à la question du développement. Une quête qui tient compte de l’abandon des problématiques liées à la ruralité par les sciences sociales haïtiennes, dans un contexte d’augmentation significative du nombre d’ONG évoluant dans ce même milieu. Suite à des lectures, discussions informelles et à la participation à certaines réunions ou à d’autres activités, nous nous sommes rendu compte de deux idées fortes sur la paysannerie haïtienne. La première, c’est le déclin du monde paysan haïtien et spécifiquement de son économie (Florida et Redon, 2019). Cette idée est surtout étudiée dans la littérature récente tantôt comme dynamique de décadence suivant une lecture fonctionnelle de la question (Zamy, 2021), tantôt comme expression de décapitalisation (Lafleur, 2022), d’après une grille plutôt dialectique. Sans oublier la récente analyse critique du professeur Képler Aurélien (2023), lors même qu’il analyse l’influence des expériences de la théologie de libération sur le pan rural du mouvement populaire haïtien de la période post-86. La deuxième vision dominante, c'est la reprise en boucle de l’idée que les rares organisations paysannes existantes, différentes « des organisations traditionnelles de travail» (Sylvestre, 2003), porteraient sur le développement. Encore entendu comme modernisation de comportements, de valeurs et de pratiques.
Cette conception semble inspirer non seulement des efforts consentis par l’État et les organismes de l’internationale communautaire (Louis-Juste, 2003) pour promouvoir le développement d’Haïti depuis le projet pilote de Marbial en 1948 (Bernadin, 1991). Mais plus encore, du fait que la majeure partie de ces organisations ont été créées dans ce même élan historique. Presque toutes les spécialistes de la question du développement rural depuis les années 1950 s’alignent sur cette vision, particulièrement des auteurs comme Louis-Juste (1997 ; 2004 ; 2007), Gabaud (2001), Sylvestre (2003), Dorvilier (2011) et St-Juste (2022). Il ne s’agit pas là d’une catégorisation ou d’une homogénéisation de perspective, vu que chacun de ses auteurs défend le même point de vue suivant des grilles paradigmatiques différentes comme par exemple, le paradigme fonctionnel, le structuralisme, le structuro-fonctionnalisme, l’approche systémique, l’approche individualiste et, bien sûr, le matérialisme historique.
Alors que cette conception gagne les esprits, la réalité dans bon nombre
d’espaces dans le milieu rural haïtien nous laisse faire deux constats
: non seulement celui d’un ordre de critiques contre des institutions de
développement qui est très présent dans plusieurs espaces du milieu rural haïtien,
en particulier dans le Grand Nord ; mais aussi, l’existence d’une série
d’organisations paysannes qui posent des actions contraires aux impératifs
et caractéristiques du développement. Il convient également de mentionner
certaines observations que nous avons réalisées dans les régions du Sud dans
le cadre de nos travaux avec certaines organisations paysannes depuis 2019
relatives à des expériences innovantes contre le projet Caravane changement
de l’ancien président Jovenel Moïse. Plus loin, nous pouvons également faire
référence à la résistance combien significative des paysan.ne.s de l'île-à-Vache
contre le projet « Destination touristique Île-à-Vache »
du gouvernement Martelly-Lamothe en 2013 . Nous ne pouvons ne pas mentionner
la récente expression de la solidarité paysanne autour du projet de
construction du canal sur la rivière Massacre dans la commune de
Ouanaminthe du département du Nord-Est enclenché au début du mois
d’août 2023. Une expérience qui a réuni des milliers de paysan.ne.s
autour d’un projet commun et d’un slogan revendiquant notre souveraineté
alimentaire
« KANAL LA P AP KANPE (KPK)».
Ces dynamiques en milieu paysan se joignent à des observations réalisées dans le cadre des activités d’une plateforme organisationnelle dénommée « Mouvman Òganizasyon pou Devlòpman ak Desantralizasyon Depatman Nò ak Nòdès (MODÒD)». À noter que c’est une plateforme constituée de plusieurs organisations de quelques communes de ces départements et qui a été créée après le passage du séisme du 12 janvier 2010. Elle met en place plusieurs activités, dont un programme d’alphabétisation, une École de Formation Politique, un Parc Solidarité/Jardin Solidarité, une Coopérative Finance et Solidaire et des Missions d’Etudiants pour le partage de connaissances entre étudiant.e.s et paysan.ne.s. Bien que sujettes à être récupérées par des ONG ou même par l’État, ces pratiques suivant certains membres de cette organisation participent à la promotion des valeurs communautaires et charrient dans leur essence des niveaux de contradictions et même des alternatives par rapport à ceux du développement et à son corollaire, la modernité qui promeut la libre individualité (Dorvilier, 2011).
En nous accentuant sur cette dernière expérience, nous nous sommes rendu compte qu’il existe bien un fossé entre la littérature dominante sur la paysannerie en Haïti et certaines réalités concrètes. Si ce fossé s’est construit pendant environ 75 ans, il fait déshonneur à la paysannerie haïtienne comme lieu important de résistance historique et il ne témoigne nullement d’un regain de dynamique de vivre ensemble et de résistance dans la paysannerie haïtienne existant jusqu’à aujourd’hui. Aussi, il est l’expression de relations fantomatiques entre des perspectives eurocentrées déterministes et la réalité concrète du milieu (Santos, 2011). Des grilles qui considèrent les paysan.ne.s non pas comme des sujets connaissants, mais plutôt comme des objets à connaitre, dans la mesure où elles ne tiennent pas compte de leur capacité à naviguer entre le jeu du développement et sa logique interne et leur propre vision et pratique.
C’est autour de cet écart que notre question centrale a été tournée. Laquelle se formule ainsi « En quoi les pratiques sociales mises en place par l’organisation MODÒD constituent-elles réellement des alternatives aux pratiques et visions développementistes exprimées par l’État et les institutions internationales de développement ? ». Question qui est légitime compte tenu du fait que l’organisation se dit alternative. Par rapport à cette interrogation, nous avons proposé de montrer que MODÒD met en place des pratiques sociales qui sont des alternatives aux pratiques et visions développementistes exprimées par l’État et les institutions internationales de développement. Un objectif qui a nécessité la description analytique de ces pratiques sociales du MODÒD, la compréhension des mécanismes de mise en place de ces pratiques sociales dites alternatives et l’analyse des relations que MODÒD entretient avec d’autres acteurs externes (État, ONG et autres organisations paysannes).
La grille de lecture qui nous a aidé à rendre compte de l’orientation des pratiques sociales observées au sein de l’organisation sous-étude, c'est la décolonialité. Démarche qui est conforme à la nature de l’objet puisqu’il s’agit de l’étude des pratiques contre-ordres. Elle est articulée à partir d’un dialogue établi entre les postulats de la sociologie des absences de Boaventura de Sousa Santos (2007, 2011, 2013, 2017), de la théorie des actions collectives de Michel Séguier et Bernard Dumas (1997) dans un chevauchement avec l’approche de la décolonisation de l’action de Carine Nassif-Gouin (2011) et une critique du paradigme développementiste suivant l’approche de la colonialité du pouvoir et du savoir d’Arturo Escobar (2011). Ces approches nous ont aidé à appréhender les contributions que les organisations paysannes apportent à l’invention d’alternatives au développementisme à travers leurs pratiques sociales. Lesquelles organisations se sont émergées dans le contexte où l’État et les organismes internationaux tentent d’imposer aux masses paysannes des projets qui ne cadrent pas avec leur réalité et leur aspiration. Dans ce contexte, ces structures essaient tant bien que mal de promouvoir leur modèle de bien-être en marge de celui de ces institutions (Casimir, 2018 : 38). En ce sens, nous avons considéré les paysan.ne.s non pas comme de simples sujets qui agissent en fonction des impératifs des organisations internationales et de l’État, mais, de préférence, comme artisan.ne.s de leur propre histoire (Casimir, Ibid. : 34). La perspective décoloniale nous a permis de considérer dans les pratiques sociales alternatives une dimension d’auto-prise en charge, d’affirmation de soi et de résistance contre l’imposition des valeurs du développement et d’une contestation face à ce modèle (Sainsine, 2007) imposé par l’État. D’où la contradiction entre la nation et l’État à travers leur structuration et leur évolution dans la formation sociale haïtienne (Jean Casimir, 1993).
L’usage de cette grille nous a exigé une prise en compte critique d’une certaine conception coloniale dans sa manière d’appréhender les concepts de pratique sociale, d’organisation et de développement. C’est ainsi que, dans un premier temps, nous avons dressé une critique de cinq grands courants systématisant la sociologie de la pratique sociale allant de la théorie de la contrainte sociale d’Emile Durkheim à celle de l’action pratique de Pierre Bourdieu, en passant par la tradition compréhensive de la sociologie de l’action et de l’interaction de Max Weber et Herbert Blumer et la théorie de la praxis de Karl Marx. À partir de cette critique, nous avons défini la pratique sociale comme « des actions posées par les populations subalternes en vue de promouvoir leur conception du monde. Aussi, comme des alternatives réalistes au statu quo actuel, auxquelles pourtant nous prêtons rarement attention, simplement parce que, dans nos manières de pensée, de telles alternatives ne sont ni visibles, ni crédibles » (Santos, 2011).
Dans un second temps, nous avons montré que les théories dominantes ou les approches classiques de l’analyse organisationnelle sont occidentalocentrées, car elles puisent leur fondement dans le contexte de la deuxième révolution industrielle. Évènement qui s’est manifesté avec éclat dans les sociétés occidentales, plus particulièrement dans celles de l’Europe. En construisant leurs approches, ces théoriciens de l’organisation, dont Frederic W. Taylor, Max Weber, Henry Mintzberg, Karl Marx, Michel Crozier et Hérard Friedberg, ne font que dégager les principes d’administration et de direction du travail dans des organisations industrielles. De là, ils nient les démarches entretenues par des groupes dits marginalisés issus plus fondamentalement des pays du Sud pour se construire et se regrouper afin de s’affranchir des contraintes systémiques et d’affirmer leur identité. Ainsi, l’organisation a été saisie non seulement comme une stratégie d’action collective qui met en place un triple processus de conscientisation, d’organisation et de mobilisation, mais elle est plus encore un dispositif et cadre de coconstruction d’un nouveau rapport au monde et un espace de décolonisation de l’action (Nassif-Gouin, Op. Cit. : 76-90).
Dans un troisième et dernier temps, partant d’une critique de l’histoire de la notion du développement, nous l’avons situé non seulement dans le cadre des nouvelles formes de relations internationales depuis la seconde guerre dite mondiale (Gilbert Rist, [1996]. 2013), mais également comme l’expression d’un discours de pouvoir qui rentre dans le cadre d’un rapport moderne-capitaliste et colonial s’adaptant aux mutations de la colonialité du pouvoir et du savoir (Escobar ([1999]. 2011 ; Rougier, 2023).
Les considérations méthodologiques ont été dressées, en cinq (5) points. Conformément à notre question centrale et à notre grille d’analyse, nous avons adopté la démarche qualitative à travers la Recherche-Action suivant les étapes dressées par Jean Mc Niff, Lomax et Whitehead Cité par André Dolbec et Luc Prud’Homme (2009) et le modèle de systématisation dans l’action ou systématisation d’expériences (Mission Inclusion, 2020). La Recherche-Action nous a permis de dresser les grandes étapes de la recherche et d'élaborer le plan du travail, et la systématisation dans l’action nous a permis non seulement de mieux appréhender la nature des objectifs poursuivis, mais aussi de connaitre les types de données à construire sur le terrain. Ces données ont été construites et analysées suivant la méthode d’analyse par catégories conceptualisantes élaborée par Pierre Paillé et Alex Mucchielli (1994). Cette méthode prend en compte les deux premières étapes de la théorisation ancrée, à savoir la codification et la catégorisation. Ainsi, nous avons construit de manière ancrée trois grandes catégories, à savoir : l’autonomisation6, la conscientisation multi-sites7 et la pluriversalité du savoir (Eberhard, 2008 ; Bourguignon et Philippe, 2016 ; Escobar, 2018). Ces catégories nous ont permis de jeter les bases d’une théorisation du phénomène organisationnel en contexte rural, à savoir la théorie perceptionnisme à partir de ce que nous appelons «les formes organisationnelles de perception du monde».
Nous avons adopté l’approche monographique en étude de cas en considérant la plateforme organisationnelle dénommée « Mouvman Òganizasyon pou Devlòpman ak Desantralizasyon Depatman Nò ak Nòdès (MODÒD) ». Une plateforme qui a des organisations membres issues de trois départements, dont le Nord (communes de Cap-Haïtien, Milot, Grande Rivière du Nord et Acul du Nord); du département du Nord-Est (communes de Sainte-Suzanne et de Ferrier) et du département de l’Ouest (Port-au-Prince). La période considérée est celle allant de 2010 à 2020. Nous avons construit un échantillon de 17 participant.e.s plus ou moins représentatif de l’ensemble des structures membres du MODÒD. Nous avons trois catégories d’acteurs clés : il s’agit des participant.e.s membres des organisations de base, des participants membres fondateurs et des participant.e.s membres d’organisations de support. Comme procédé, nous avons utilisé l’échantillonnage au jugé donc, non probabiliste. En fin de compte, nous avons utilisé trois principales techniques de production de données, à savoir : l’entretien (individuel et collectif), l’observation et la recherche documentaire, tout en respectant le principe de triangulation des données.
Les principaux résultats obtenus ont été présentés dans trois chapitres qui portent sur nos trois objectifs spécifiques et une conclusion. Le quatrième chapitre traite de la contextualisation de notre objet d’étude et de la présentation des mécanismes de mise en place de pratiques sociales au sein de l’organisation. Le cinquième chapitre fait la description analytique des pratiques économiques, politico-sociales et épistémiques de l’organisation. Et le sixième chapitre qui analyse les relations que le mouvement entretient avec les acteurs extérieurs (ONG, l’État et les autres organisations de la région).
En ce qui concerne la contextualisation de l’objet d’étude, nos données nous ont montré que la création de l’organisation MODÒD est fonction d’un double contexte. Un contexte structurel lié à une mémoire de lutte traduite par une conscience historique (Duquette, 2011) des membres, qui tiennent compte de l’importance de ces départements comme des hauts lieux de résistance historique dans le pays. Et un contexte conjoncturel, lié à la volonté de construire une autre vision de la décentralisation et pour contrecarrer les ONG qui prétendaient contribuer au « développement » du pays surtout après le séisme du 12 janvier 2010. En effet, ce processus de construction de sens au sein du mouvement est lié à sa composition, sa vision, sa structuration ; aux activités collectives ou pratiques sociales en son sein ; et à ces effets collectifs comme mécanismes de mise en place de pratiques sociales alternatives. En ce qui concerne ce dernier aspect de la question, nous en avons identifié quatre fondamentalement, à savoir : la solidarité à travers l’existence de réseaux d’interrelations structurées ; l’autofinancement et l’autogestion ; la transparence et la participation ; et enfin, la justice sociale et la mise en œuvre d’une économie socialement responsable.
Pour ce qui est des pratiques sociales à caractère économique, l’organisation les met en place pour être autonome et pour contrecarrer les conséquences des projets de développement. Des pratiques économiques qui reflètent son slogan « Grès kochon kuit kochon ». Ce proverbe traduit une volonté de la part du mouvement de s'autoconstruire avec les ressources disponibles dans une forme de symbiose et de coopération mutuelle. Ce, pour éviter toute dépendance vis-à-vis de certains organismes étrangers comme des ONG, des personnalités politiques ou même de l’État. Les activités qui assurent ce rôle sont : l’initiative Coopérative Finance et Solidaire mise en place en 2014 qui répond à des besoins sociaux, non à la rentabilité du capital ; l’activité parc solidarité/jardin solidarité pensée et menée par et pour les paysan.ne.s suivant un principe de participation équitable ; et le « kole men » ou le « men kontre », comme l’expression d’une solidarité réciprocitaire.
L’un des objectifs du MODÒD, c’est de participer au processus de conscientisation de ses membres pour qu’ils.elles puissent s’affranchir de leur situation d’oppression et d’appauvrissement. Pour matérialiser cet objectif, il met en place un système de formation comme espace de dialogue entre diverses catégories de membres. Puisqu’il rassemble, en plus des paysan.ne.s, des étudiant.e.s, des professeurs et des enseignants et professionnel.le.s qui, pour la plupart, évoluent en milieu urbain, l’organisation représente un milieu idéal de procès de connaissance. D’une part, les paysan.ne.s prennent conscience non seulement de leur réalité matérielle, mais également de l’importance des connaissances scientifiques dans le processus de transformation de la réalité actuelle. D’autre part, il y a la prise de conscience des professeurs, enseignants et étudiant.e.s membres de la structure, sur l’importance et la portée des savoirs des paysan.ne.s. C’est ce que nous appelons la conscientisation multi-sites, qui vise à combattre « la double complexe 8». Les activités qui jouent ce rôle sont : l’Alfa-MODÒD, l’École de Formation Politique du MODÒD (LFPM en créole) et les Missions d’étudiants.
La dimension épistémique des pratiques a été étudiée à partir de la présentation du profil sociodémographique des interviewé.e.s qui nous a donné une idée des différentes personnalités qui composent MODÒD. Une diversité qui se présente au niveau du statut, des professions, des milieux d’habitation, des âges, des sexes et également des religions des membres. Cela nous a permis de comprendre l’immensité des savoirs multiples qui se croisent dans la structure à travers une multiplicité de facettes et de subjectivités visant à concrétiser un projet alternatif commun. C’est ainsi que nous avons compris en fin de compte qu’effectivement MODÒD est un espace de pluriversalité du savoir et un laboratoire d’une pensée sociale autre.
La mise en place de ces pratiques sociales au sein du MODÒD est fonction de ses perceptions des structures extérieures et du monde social. Ainsi, nous avons compris que les relations entre MODÒD et l’État s’orientent en fonction d’une perception critique qui tend à le concevoir comme une structure politique qui prend une orientation coloniale et capitaliste et qui œuvre contre la masse paysanne. C’est pourquoi le mouvement s’engage dans toute une dynamique de mobilisation qui prend plusieurs formes. Pour ce qui est des ONG et certaines organisations du milieu, le mouvement les conçoit comme des institutions qui participent à la dynamique de domination de l’étranger sur le pays. Cependant, en dépit de cette position clairement affirmée et assumée, certaines des organisations membres du MODÒD participent parfois à des projets de développement. Une situation qui exprime des niveaux de négociation entre l’organisation et ces structures. À ce stade, cette notion établit un équilibre entre ce que l’organisation a à perdre quand ses pratiques ou ses activités sont en baisse et que les moyens pour les financiers ne répondent et ce qu’elle a à gagner quand elle participe à des projets qui permettent en quelque sorte une certaine dynamisation. Donc, nos données nous ont montré que la négociation au sein du mouvement est une logique stratégique.
En outre, malgré cet effort consenti par l’organisation et en dépit des sacrifices, force est de constater une désagrégation depuis quelques années. Cet affect est lié à des rencontres qui peinent à se réaliser, à des responsabilités non assumées parfois, à des activités dysfonctionnelles, etc. Aussi, cette situation résulte de la réalité socio-politique et économique difficile et du niveau de vie des paysan.ne.s. Le mouvement souffre également d’un problème de renouvellement de membres et de recrutement d’autres organisations. Sur un plus haut niveau plutôt épistémique, nous estimons que malgré qu’elles constituent des alternatives, les pratiques sociales restent dans le premier niveau de décolonisation de l’action. Les perspectives vers une décolonialisation de l’action ou même vers la décolonialité de l’action (Nassif-Gouin, 2019) tardent encore à se faire sentir, en dépit de la mise sur pied de l’École de formation politique. Face à ces obstacles, les membres du mouvement ont montré : la nécessité du renforcement du travail de conscientisation ; celle de développer des relations politico-économiques avec des organisations d’autres pays, particulièrement celles de l’Amérique latine, qui défendent les mêmes projets de monde ; et l’engagement dans une politique de visibilité et de visibilisation pour le renforcement de la capacité d’action du mouvement.
En somme, à partir des données analysées, nous avons montré que les pratiques sociales du MODÒD constituent réellement des pratiques alternatives face à celles du développement imposées par l’État et les organismes internationaux dedéveloppement,t en dépit de ses limites et de sa désagrégation. Ainsi, nous avons pu réellement systématiser une expérience concrète à partir d’une grille de lecture décoloniale qui nous a permis de produire plus ou moins une réflexion alternative sur les alternatives existantes (Santos, 2011).
13/02/2025
1Ce texte reprend quelques éléments que nous avons soulignés dans notre présentation lors de la soutenance. Il vise à faciliter la lecture de plus d’un.une du texte.
2Ce mémoire a pour titre Vers une analyse décoloniale des pratiques sociales des organisations paysannes face à la question du développement, cas du « Mouvman Òganizasyon pou Devlòpman ak Desantralizasyon Depatman Nò ak Nòdès (MODÒD) » (2010-2020) et réalisé en septembre 2024.
3Un peu pour faire écho à la réalité décrite dans le texte « Tribulations et joie de vivre » du sociologue Jean Casimir. Voir Casimir, Jean. 2018. La nation haïtienne et l’État. Montréal : Les Éditions du CIDIHCA. p. 177-219.
4Les organisations paysannes traditionnelles ou encore les structures traditionnelles de travail regroupent les combites, escouades, ranponneau, douvanjou, etc. Michel Laguerre est l’un des premiers auteurs à proposer une description de la structuration de ces types d’organisations, classées selon lui en trois catégories : Combite, Escouades et Sociétés de travail. Voir Laguerre, Michel. 1975. Les associations traditionnelles de travail dans la paysannerie haïtienne. Port-au-Prince : HCA.
5 Walner Osna, doctorant en sociologie à l’Université d’Ottawa, a réalisé une magnifique thèse de maîtrise sur cette question en démontrant que la résistance paysanne contre le projet (éco)touristique du gouvernement de l’époque est l’expression des rapports de domination entre un État issu d’une matrice coloniale et sa population. Voir Osna, Walner. 2020. Une analyse sociohistorique de la résistance paysanne de l’Ile-à-Vache (Haïti) face au projet de développement (éco) touristique de l’État. Université d’Ottawa. Thèse de Maîtrise en sociologie.
6L'autonomie a été définie au sens de Claudia Bouguignon Rougier comme forme de défense de territoires, de structures et de modes de vie menacés par les projets des multinationales de l’agroalimentaire, d’extractivistes ou de projets de développement et comme une façon de résister aux stratégies létales de divers groupes mentionnés qui, sans se concerter nécessairement, ont des intérêts communs. Voir Rougier, Claudia Bouguignon. 2023. Un dictionnaire décolonial. Toulouse : Éditions Europhilosophie.
7La conscientisation multi-sites traduit un processus de conscientisation à double niveau. D’une part, il s’agit d’une conscientisation des paysan.ne.s membres de l’organisation sur l’importance de la connaissance scientifique dans la construction d’une masse critique pour dépasser le système ou pour mieux construire l’alternative. D’autre part, c’est un processus qui traduit un regain de conscientisation des étudiant.e.s, des professeur.e.s d’université et des professionnel.le.s (intellectuels) membres du MODÒD, sur l’importance et la portée extrêmement intéressante des savoirs et connaissances des paysan.ne.s pour renforcer les dynamiques de lutte.
8La notion de double complexe dans notre travail renvoie à l’idée que les intellectuel.le.s/étudiant.e.s ou, plus précisément, les universitaires soient plus « intelligent.e.s » que les paysan.ne.s parce qu’ils/elles sont instruit.e.s ou « hautement scolarisé.e.s » (complexe de supériorité) et à l’interiorisation faite par certain.ne.s paysan.ne.s de cette idée (complexe d’infériorité).
Aurélien, Képler. 2023. Le mouvement populaire Haïtien post-1986. Appropriation des héritages de la théologie de la libération. Paris : L’Harmattan.
Bernadin, Ernst A. 1991. L’espace rural haïtien : bilan de 40 ans d’exécution des programmes nationaux et internationaux de développement (1950-1990). Port-au-Prince : Éditions des Antilles S.A.
Casimir, Jean. 1993. « Histoire de l’État et histoire de la nation ». Dans Barthélemy, Gérard et Christian Girault (dir.). La République haïtienne : État des lieux et perspectives. Paris : Éditions KARTHALA. Pp 33-42.
Casimir, Jean. 2018 a. La nation haïtienne et l’État. Montréal : Les Éditions du CIDIHCA.
Casimir, Jean. 2018 b. Une lecture décoloniale de l’histoire des Haïtiens : Du traité de Ryswick à l’occupation américaine (1697-1915). Préface de Walter D. Mignolo, Port-au-Prince : Communication Plus.
Chery, Kervens. 2024. Vers une analyse décoloniale des pratiques sociales des organisations paysannes face à la question du développement, cas du « Mouvman Òganizasyon pou Devlòpman ak Desantralizasyon Depatman Nò ak Nòdès (MODÒD) » (2010-2020). Mémoire de licence. Faculté des Sciences Humaines (FASCH). Université d’État d’Haïti (UEH). Non publié.
Dolbec, André et Luc Prud’Homme. 2009. « La recherche-action ». Dans Gauthier, Benoît (dir.). Recherche sociale : de la problématique à la collecte des données. Québec : Presses de l’Université du Québec.
Dorvilier, Fritz. 2011. Gouvernance associative et développement local en Haïti. Port-au-Prince : Éditions de l’Université d’État d’Haïti.
Dumas, Bernard et Michel Séguier. 1997. Construire des actions collectives : Développer les solidarités. Lyon : Chronique Sociale.
Eberhard, Christoph. 2008. « De l’univers au plurivers. Fatalité, utopie, alternative ? ». Mondialisation : utopie, fatalité, alternatives ?. Bruxelles : Presses Universitaires Saint-Louis.
Escobar, Arturo. [1999]. 2011. « L’invention du développement ». Current history, vol. 98. No 631. Traduction et publication par DIAL (Diffusion d’Information sur L’Amérique latine. http://enligne.dial-infos.org
Florida, Dieupuissant et Marie Redon. 2019. « L’espace rural haïtien en mutation : du déclin de la caféiculture au développement de l’économie informelle dans la Chaîne des Cahos ». Les Cahiers d’Outre-Mer. 279.
Gabaud, Pierre Simpson. 2001. Associationnisme paysan en Haïti : Effet de permanence et de rupture. Port-au-Prince : Éditions des Antilles S.A.
Lafleur, Jackson. 2022. La Ville dans les luttes sociales en Haïti : le cycle métropolitain des mouvements sociaux (2017-2021). Mémoire de licence. Faculté des Sciences Humaines (FASCH). Université d’État d’Haïti (UEH). Non publié.
Laguerre, Michel. 1975. Les associations traditionnelles de travail dans la paysannerie haïtienne. Port-au-Prince : HCA.
Louis-juste, Jn Anil. 1997. Sociologie de l’animation de Papaye. Unité de Formation Continue et d’Extension Universitaire. FASCH/ UEH. Port-au-Prince : Imprimeur II.
Louis-Juste, Jn Anil. 2003. « Crise sociale et internationale communautaire en Haïti ». AlterPresse. http://www.alterpresse.org/spip.php?article643.
Louis-Juste, Jn Anil. 2004. « Le développement communautaire comme ‘’logo-technique’’ en milieu rural ». Alterpresse.
Louis-juste, Jn Anil. 2007. « La question agraire haïtienne et les revendications paysannes actuelles ». Plate-forme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif (PAPDA). Port-au-Prince : Maison d’impression : Kay-Ana.
Mission Inclusion. 2020. Produisons pour construire le « Bien vivre ». Québec : Éditions des Partenaires.
Nassif-Gouin, Carine. 2019. « Comment faites-vous : De la décolonisation de l’action ». Dans Décolonialité (s) : dialogues théoriques et expérimentation. Revue Possibles. Volume 43, numéro 2. Université de Montréal.
Osna, Walner. 2020. Une analyse sociohistorique de la résistance paysanne de l’Ile-à-Vache (Haïti) face au projet de développement (éco) touristique de l’État. Université d’Ottawa. Thèse de maitrise en Sociologie.
Paillé, Pierre et Alex Mucchielli. 2012. L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales. Paris : Éditions Arman Colin.
Rist, Gilbert. [1996]. 2013. Le développement : histoire d’une croyance occidentale. 4e édition, revue et augmentée. Paris : Presses de Sciences Po.
Rougier, Claudia Bouguignon. 2023. Un dictionnaire décolonial. Toulouse : Éditions Europhilosophie.
Sainsine, Yves. 2007. Mondialisation, développement et paysans en Haïti : Proposition d’une approche en termes de résistance. Thèse de doctorat. Université Catholique de Louvain.
Santos, Boaventura de Sousa et César Rodríguez Garavito. 2017. « Alternatives économiques : les nouveaux chemins de la contestation », Dans Verschuur, Christine Et. Al. (dir.). Genre et économie solidaire, des croisements nécessaires. Cahiers Genre et Développement. N°10. Paris : L'Harmattan. Pp : 37-56.
Santos, Boaventura de Sousa. 2011. « Épistémologie du Sud ». Études rurales. Vol 187. Pp 21-50.
Santos, Boaventura de Sousa. 2017. « Pour une sociologie des absences ». El Correo.
St-Juste, Meartherlinck Jérome. 2022. « Les organisations paysannes en Haïti, entre discours et réalités : Les causes de la disparition du secteur paysan dans les nouveaux mouvements sociaux en Haïti ». Le National.
Sylvestre, Evens. 2003. Contribution des organisations paysannes au développement social de Thomassique. Mémoire de licence. Faculté des Sciences Humaines (FASCH). Université d’État d’Haïti (UEH). Non publié.
Zamy, Lauwens Billy. 2021. La décadence des associations de travail dans la paysannerie haïtienne au regard des politiques agricoles : cas des associations de travail de Trou Canari, 5e section communale de Petit-Goâve. Mémoire de licence. Faculté des Sciences Humaines
(FASCH). Université d’État d’Haïti (UEH). Non publié.COPYRIGHT L'avant-gardiste @ 2024. Tous droits réservés